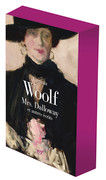La Pléaide
Recherche rapide
Le Cercle de la Pléiade
- La Pléiade /
- La vie de la Pléiade /
- L’actualité de la Pléiade /
- Une pièce à soi, extrait.
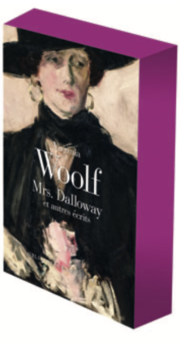
-
Nouveauté
Arthur Schopenhauer
Le Monde comme volonté et représentationParution le 23 Octobre 2025
En savoir plus
1728 pages, Prix de lancement 72.00 € jusqu'au 31 01 2026
Une pièce à soi, extrait.
Mai 2025
Ma tante, Mary Beton, je dois vous le dire, est morte d’une chute de cheval alors qu’elle sortait prendre l’air, à Bombay. La nouvelle de mon héritage me parvint un soir, à peu près au moment où fut votée la loi accordant le droit de vote aux femmes. Le message d’un notaire tomba dans la boîte aux lettres et, quand je l’ouvris, j’appris que ma tante m’avait légué cinq cents livres par an, à jamais. Des deux choses — le vote et l’argent —, j’avoue que l’argent me parut infiniment plus important. Avant cela, je gagnais ma vie en mendiant de petits travaux dans les journaux [...]. Telles étaient les principales occupations accessibles aux femmes avant 1918. Inutile, je le crains, de décrire en détail combien ces tâches étaient pénibles, car vous connaissez peut-être des femmes qui les ont accomplies, ou combien il était difficile de vivre avec l’argent ainsi gagné, car vous avez peut-être essayé. Mais ce qui m’a laissé le souvenir d’une torture pire encore, c’était le poison de la peur et de l’amertume que cette époque a suscitées en moi. Pour commencer, faire toujours un travail qu’on ne souhaite pas faire, et le faire comme un esclave, par la flatterie et la flagornerie, ce qui n’était peut-être pas toujours nécessaire, mais qui semblait l’être, les enjeux étant trop grands pour prendre des risques ; et puis l’idée de ce talent que je mourais de devoir cacher, talent petit mais cher à qui le possède, ce talent qui périssait et avec lui mon être même, mon âme — tout cela devenait comme une rouille rongeant la fleur du printemps, détruisant l’arbre en son cœur. Toutefois, comme je le disais, ma tante est morte ; et chaque fois que je fais de la monnaie sur un billet de dix shillings, un peu de cette rouille et de cette corrosion s’efface ; la peur et l’amertume s’en vont. Vraiment, pensai-je, rangeant les pièces dans mon portefeuille et me rappelant l’amertume de cette époque, c’est admirable à quel point un revenu fixe peut entraîner un changement de tempérament. Aucune force au monde ne peut me prendre mes cinq cents livres. J’ai à jamais de quoi me nourrir, me loger et me vêtir. Ce ne sont donc pas seulement l’effort et le labeur qui cessent, mais aussi la haine et l’amertume. Je n’ai besoin de haïr aucun homme ; il ne peut me nuire. Je n’ai besoin de flatter aucun homme; il n’a rien à m’offrir. Imperceptiblement, j’en suis donc venue à adopter une nouvelle attitude envers l’autre moitié de la race humaine. Il était absurde de blâmer une classe ou un sexe dans son ensemble. Les grands groupes humains ne sont jamais responsables de ce qu’ils font. Ils sont guidés par des instincts qu’ils ne maîtrisent pas. Eux aussi, les patriarches, les professeurs, devaient affronter d’infinies difficultés, de terribles inconvénients. Par certains côtés, leur éducation avait été aussi critiquable que la mienne. Elle avait provoqué en eux des défauts aussi grands. Certes, ils avaient l’argent et le pouvoir, mais seulement à condition de loger dans leur sein un aigle, un vautour, qui leur arrachait constamment le foie et leur picorait les poumons : l’instinct de possession, la rage de l’acquisition [...]. De fait, l’héritage de ma tante me dévoila le ciel, et à la silhouette imposante et massive d’un gentleman, que Milton recommandait à mon adoration perpétuelle, s’est substituée une vue à ciel ouvert.
Traduit de l'anglais par Laurent Boury.
Auteur(s) associé(s)



 Agrandir
Agrandir Diminuer
Diminuer